Ghislane Guedira Bennouna

Mohamed El Babsiri

Ahmed Khalid Seghrouchni

Nouaman Al Aissami

Khaoula Lachguar

Ali Bensouda

Khalid Safir

Ça a débuté comme ça…
Ce fût un grand moment de vérité. La crise n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est aussi une crise de l'époque. Décaler, prolonger, extrapoler, procrastiner, ça on savait faire. Mais, (re)démarrer, (re)construire, (re)naitre, (re)fondre, ça, nous devons absolument apprendre très vite à le réaliser.
Découvrez la nouvelle réflexion de Monsieur Hamid Tawfiki.

« Exprimez le désir d'obliger, prononcez avec grâce des phrases sentimentales, faites des dupes, et gardez-vous de le devenir en pratiquant vos maximes : le crédit n'est pas un revenu, c'est une somme qui s'épuise à mesure qu'on la dépense. » François Droz
Vous connaissez certainement le foisonnant roman de Louis-Ferdinand Céline qui raconte l’enfance et la jeunesse d’un médecin aigri et vieillissant, nommé Ferdinand.
Dans cette histoire, il y a une succession de cahots sur la route, de creux et de bosses, de défis à relever ou à refuser. C’est la farandole des agités du bocal, dégoûtants, ratés, cochons, mal pensants, idiots, poivrots, rêveurs, penseurs. C’est la fresque de l’humanité que personne ne veut montrer, le concerto des détraqués. Mais c’est aussi l’espoir que l’on entend sous les hurlements. L’espoir qui pave le chemin de la jeunesse. Il est partout, cet espoir du devenir. Il est dans les yeux de Ferdinand, dans son étrange fidélité à ses entreprises vouées à la damnation. Ce livre est une démonstration de sensibilité inégalée.
Je pense que vous avez bien identifié cette œuvre. Bravo ! Il s’agit bien sûr de Mort à crédit. Mais quel est le lien avec notre chronique ? Je vous laisse découvrir.
Revenons à l’actualité du moment. Rappelez-vous, l’endedandage est notre Kairos. Nous vivons indéniablement une époque singulière, un vrai moment Dirac. La Pandémie a brutalement cahoté notre économie en brisant la dynamique productive. Sans hésitation, la dislocation s’est mise en route, tambour battant. Le virus, sans voix, répète mille fois, à qui veut l’entendre, ce refrain, cette douce menace «Laissez-nous juste le temps de vous détruire».
Le silence, qui a suivi, fût, aussi, un moment de pédagogie. En effet, on a tous découvert, à notre insu, les coulisses du fonctionnement de l’économie: les dépendances (mal)heureuses, les liaisons dangereuses, les ignorances désinformées, les essentiels oubliés, les Baba Vanga canada dry, les frilosités natives, les pulsions inconscientes, les gâchis en voici en voilà, les dettes qui alanguissent, les prêts qui stimulent, Fabrizzi-Ponzi-Prestiti, l’informel ce célèbre inconnu, le déséquilibre permanent, la peur de la peur, Etat protecteur, Etat providence. Une plongée en eaux troubles (in)connues.
Ce fût un grand moment de vérité. La crise n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est aussi une crise de l'époque. Décaler, prolonger, extrapoler, procrastiner, ça, on savait faire. Mais (re)démarrer, (re)construire, (re)naître, (re)fondre, ça, nous devons apprendre, fissa, à le réaliser. Bien sûr qu’on veut garder le meilleur du passé, mais il faut voir qu’il y a un vrai virage à prendre et qu’il nous faut le prendre avec élan. Nos valeurs nous questionnent et nos enfants nous regardent.
Les États ont très vite réagi à la chute de l’activité économique : prise en charge du chômage partiel, distribution des aides aux vulnérables, garantie des financements de trésorerie, éviter, coûte que coûte, des faillites massives. Ils ont ainsi bien traité le court terme en achetant du temps.
Aujourd’hui, pour préparer l’avenir post-crise, à plus long terme, les États doivent relancer l’activité, questionner leur modèle économique, définir les priorités, aider les entreprises à investir, contribuer au financement des (re)localisations d’industries stratégiques.
Ainsi tous les pays s’apprêtent à sortir du temps de l’urgence et engager une action patiente et sélective pour (re)construire l’avenir. Face à l’ampleur grandissante de la crise, la seule réaction d’urgence n’est qu’un prélude à l’action durable. Une vraie réponse devra avoir comme vocation de refonder le modèle économique pour les décennies à venir. Nous allons avoir une hausse considérable et durable du besoin de financement des entreprises et des états. En effet, l’addition des plans de «relance», de «sauvetage», de «survie» des économies représenterait plusieurs milliers de milliards de dollars.
Aussi avons-nous constaté que quel que soit le programme de relance retenu, son financement est un pur casse-tête chinois. En effet, le quantum et la nature des risques y afférant sont à la fois potentiellement infinis et indéfinis. La taille des montants est bien évidement un sujet. Les incertitudes et les aléas aussi. Les probabilités changent de dimension. Ce qui était improbable est devenu possible. Les bébés cygnes noirs ne sont plus une illusion, ils sont même beaucoup plus réels que par le passé.
« Que faire du crédit, sinon le risquer? » Jean-Paul Sartre
Par conséquent, les bailleurs de fonds, les banques, les investisseurs institutionnels, les marchés de capitaux, doivent épouser totalement la transformation programmée de l’économie, en étant un cœur dynamo. Ils doivent refléter dans leurs offres, leurs allocations de capital, leurs appétits de risque, les nouvelles priorités et les nouvelles exigences de la (re)construction. Mais cela ne suffira pas. Les États devront fortement contribuer, beaucoup rassurer, sans cesse encourager, subtilement convaincre qu’ils resteront le dernier recours, une ultime ressource. Ils auront à défier leurs ratios, à ignorer, temporairement, leur discipline budgétaire et à user de tout l’arsenal à leur disposition pour créer une dynamique, initier un mouvement.
L’État devra s’endetter, beaucoup s’endetter. Son «bilan» et son «hors Bilan» vont très fortement enflés, et utiliseront plusieurs nuances de gris. Abus de crédit public. Faillite des États. Banqueroute des États. Aujourd’hui, au sein de Pantopie, dans tous les pays, avancés ou émergents, on renoue avec un vocabulaire relevant d’autres temps et pour certains, réservé à d’autres continents.
Une question, qui pourrait surprendre, mérite néanmoins d’être posée : L’État a-t-il l’obligation de payer ses dettes ? la réponse pourrait être nuancée. Il paraît en effet évident que l’État, siège de la puissance souveraine, ne puisse pas répondre à ses obligations contractuelles ou quasi délictuelles parce qu’il est justement l’autorité souveraine indépendante et libre de tout pouvoir.
« En somme, tout pouvoir est exactement dans la situation d'un établissement de crédit dont l'existence repose sur la seule probabilité (d'ailleurs très grande), que tous les clients à la fois ne viendront pas le même jour réclamer leurs dépôts. » Paul Valéry
En effet, s’il est vrai que la question des déficits publics a toujours été le conundrum des gouvernements, celle de la dette publique reste un sujet tabou. La dette n’est peut-être pas un problème… tant que le débiteur trouve des prêteurs, apparaît solvable à long terme et maîtrise l’équilibre entre ses ressources récurrentes et ses obligations de remboursement. Il n’y a pas de chiffre magique pour le maximum d’endettement, tout dépend des multiples facteurs qui déterminent la pérennité financière de chaque État. Or il est certain aujourd’hui que les dettes publiques vont bondir dans les prochains mois. Par conséquent chaque État devra donner des gages de sa solvabilité à long terme.
« On ne meurt pas de dettes. On meurt de ne plus pouvoir en faire ». Louis-Ferdinand Céline
L’État est supposé vivre éternellement et il est en mesure de renouveler indéfiniment sa dette en levant l’impôt, du moins tant qu’il en a la légitimité politique. Cette croyance a cependant totalement explosé quand les autorités grecques ont été poussées à faire officiellement défaut en mars 2012 et que la crise européenne des dettes souveraines a pris la suite d’une crise localisée de dettes privées.
Jamais un État de l’Europe occidentale n’avait, en effet, fait défaut depuis les accords de Londres intervenus le 27 février 1953, selon lesquels la dette publique allemande avait fait l’objet d’une restructuration et d’une annulation partielle. Le défaut souverain apparaît parmi d’autres et, depuis la fin du XXe siècle, comme le symptôme d’une crise du capitalisme de croissance. Cette situation est d’une triste banalité historique puisqu'on a pu recenser à travers le monde quelques défauts d’États pendant ce siècle. L’Espagne a fait faillite 13 fois depuis son indépendance ; le Venezuela 6 fois ; le Brésil, l’Équateur et le Chili 9 fois ; la France, l’Allemagne, le Mexique, le Pérou et l’Uruguay 8 fois alors que des États comme le Canada, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, la Finlande ou la Belgique n’ont jamais fait défaut.
La notion de défaut souverain est la négation de la souveraineté des États puisque les gouvernants du pays considéré se retrouvent dans l’impossibilité de payer entièrement leur dette. Ils perdent alors leur «crédit» public et la confiance des prêteurs potentiels et des souscripteurs d’obligations d’État. Sous forme de pressions politiques et économiques, d’occupations physiques – voire militaire – ou plus généralement ce qu’on nomme la «diplomatie de la canonnière», l’État faisant défaut perd de facto sa souveraineté alors même qu’il a, par définition, le contrôle de sa situation et ne peut être de jure contraint à rembourser ses dettes.
Dans ce prolongement, la notion de défaut souverain affirme de manière spécifique l’individualité des États à l’instar des emprunts des particuliers : bien qu’ayant le devoir juridique – voire moral – de payer, les gouvernants n’ont plus la volonté ou la capacité de payer leurs « dettes souveraines ».
L’histoire montre que cette volonté ou cette capacité peut ne pas exister : c’est la faillite ou la banqueroute d’État. La période contemporaine entend davantage promouvoir la «maîtrise» des dettes publiques par des procédés ou par des mécanismes de certification des comptes publics, de notations, de primes de risque ou de gestion active de la dette publique sans pour autant que ces techniques puissent exclure dans le temps les précédentes expériences.
L’autre question qui mérite d’être posée : comment les sociétés financières peuvent épouser totalement la transformation programmée de l’économie ? En régime permanent, le rôle majeur des marchés financiers dans la distribution du crédit a un contenu politique, car il affecte la répartition générale des ressources, les inégalités et les perspectives de croissance qui vont avec.
Au cours des trente dernières années, la régulation financière a été réorientée suivant un projet politique visant à établir des « marchés efficients » où des « investisseurs libres » contribuent à une « allocation optimale » des ressources, et un « État minimal » réduit à un simple rôle de «garant» du fonctionnement du système.
Cependant, l’établissement de nouveaux cadres de l’industrie financière informés par ces concepts a progressivement conduit à un effacement des marques de la généalogie politique dont ils procèdent : ils apparaissent ainsi finalement comme de simples outils techniques aux mains des professionnels aptes à les manipuler dans des contextes pratiques.
L’idée initiale d'Eugène Fama est que le marché financier est une interface très efficace qui facilite les prises de décisions financières dans l’entreprise et joue un rôle essentiel dans l’allocation optimale des ressources financières. Le marché fait ainsi la synthèse et agrège les informations détenues par les investisseurs. Les cours ont un sens, ils sont le reflet et l’expression de l’activité économique. L’efficacité d’un marché financier dans le sens informationnel serait sa capacité à transformer de l’information en prix. Les «marchés efficients » comme espace de la distribution du crédit.
Or, un marché financier peut être plus ou moins efficace dans le sens où le prix peut intégrer plus ou moins d’informations. Il peut exister une déperdition (un bruit) dans ce processus de transformation de l’information, et une question pertinente pourrait être celle du niveau d’efficacité du marché considéré, c’est-à-dire le «rendement» du marché à transformer de l’information. En d’autres termes : le marché fonctionne-t-il bien ? This is it.
Une approche anthropologique du sujet nous enseigne que les institutions sociales chargées de gérer et d’arbitrer les rapports de forces sont par excellence le lieu du politique. Leur analyse implique de comprendre la manière dont les conflits autour de l’accès aux ressources font sens pour les participants, à la fois ceux qui les gèrent et ceux qui les subissent. Ce sens concerne les identités sociales au sein des hiérarchies établies dans ces rapports de forces, et la manière dont elles définissent l’ordre politique légitime dans une situation donnée.
Analyser le rôle distributif de la finance contemporaine implique alors de comprendre la manière dont ses employés font sens de leurs pratiques, lorsqu’ils décident d’acheter et de vendre des actifs qui constituent une source fondamentale de financement pour l’économie globale. Ceci permet de questionner la façon dont ils conçoivent les rapports sociaux hiérarchiques qu’ils contribuent à constituer par cette distribution. En somme, les marchés sont efficients en théorie, mais en pratique, ils sont pragmatiques, cyniques, nostalgiques.
En temps de crise, et pas n’importe quelle crise, tout le monde s’accorde à dire que toutes les parties prenantes doivent bien agir, parfois même agir contre soi, pour sortir ensemble par le haut de cette heureuse Chrysalide, avec une meilleure version d'elles-mêmes : Un Etat courageux, clairvoyant et garant. Un marché financier responsable, moins naïf et moins fourbe.
« Je veux croire que cette traversée du temps retrouvé, grâce notamment aux pouvoirs de la littérature, de la philosophie et de la poésie, permettra le réveil de la sensibilité, de la contemplation, de la vie intérieure. Si coronavirus épargne l’intégrité de notre organisme, il révélera la solidité de notre âme.» Sylvain Tesson
Ciment & Covid-19 : Des fissures se dessinent sur le court terme
Une étude de l’équipe Recherche Action de CDG Capital concernant le secteur du ciment à l’épreuve de la COVID-19.
Retrouvez les détails dans le document ci-dessous.
Les trois Infinis ou le trio de notre curiosité
Le grand défi du 21ème siècle serait a priori de faire du risque systémique notre clarté.
Il s’agirait, pour nous tous, de développer une vision globale de l'organisation du monde. Cette approche reposerait sur des systèmes interactifs qui se tiennent, s’enchaînent, se bouclent, s'imbriquent créant "la complexité".
Nous aurions aussi à développer une nouvelle méthode pour analyser globalement le monde. Ce qui veut dire adopter une approche systémique.
Découvrez une nouvelle réflexion de Monsieur Hamid Tawfiki.
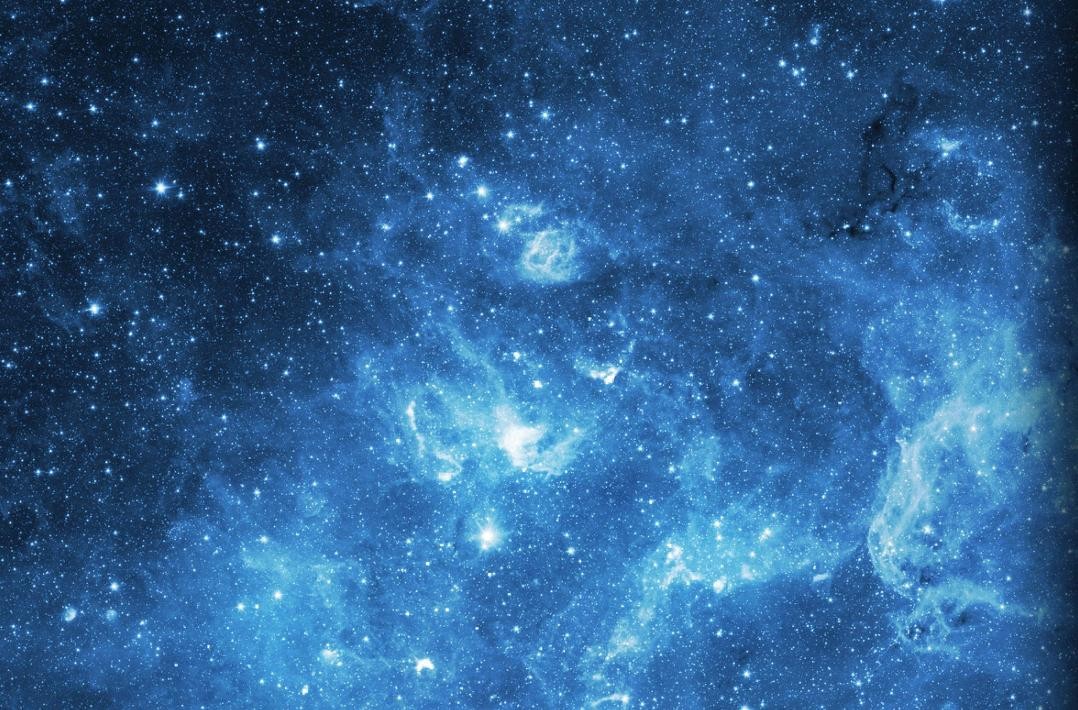
« Nous allons entreprendre un voyage dans un monde souterrain, le monde des significations cachées derrière l'apparence des choses, le monde des symboles où tout est signifiant, où tout parle pour qui sait entendre. » Amadou Hampâté Bâ
En grec, l'infini se disait "apeiron". Ce mot péjoratif désignait à la fois l'infini et l'indéfini, il désignait aussi le chaos originel. Alors que chez les Romains, ce symbole étrange, ce huit paresseux, était utilisé pour représenter 1000, puis un grand nombre. A l’époque, l’infini était petit !
Savez-vous qu’au début, l’infini était interdit ? L'infini se disait de Dieu et tout ce qui est ontologiquement second à Dieu était seulement indéfini, c'est-à-dire qu'il traduit l'ignorance du sujet. L’indéfini se dit du monde physique et des mathématiques et désigne ce dont on ne peut prouver les bornes. Sa véritable nature est l'indétermination, puisque ni fini, ni infini.
L’infini, quand il n’y en a plus, il y a Cantor!
En effet, chez les mathématiciens, l’infini a été un des plus importants sujets de discorde de l’histoire. Tout cela à cause des travaux d’un seul homme, Georg Cantor qui, en 1874, pour la première fois dans l’histoire réussissait à appréhender l’infini avec rigueur, mais certains de ses résultats remirent en cause les bases sur lesquelles se fondaient les mathématiques depuis des siècles. Son célèbre article est révolutionnaire car, pour la première fois, l’infini est considéré non plus comme une limite inatteignable mais comme un possible objet d’investigation.
Les trois infinis, le trio de notre curiosité : le petit, le grand et le complexe
En général, le mot trio est utilisé pour désigner une composition musicale écrite pour trois parties vocales ou instrumentales, ou pour décrire un groupe de trois personnes qui vivent, s'amusent ou agissent ensemble. De notre enfance cinéphile, quel célèbre trio nous a permis de rêver d’ailleurs et de se projeter dans le désert en choisissant son personnage préféré ? Et si je vous disais Ennio Morricone et Sergio Leone ? Bravo ! voici, notre trio débusqué, en trois secondes, et en trois langues. Il s’agit bien de la triade western : Le Bon, la Brute et le Truand ; The Good, the Bad and the Ugly ; Il Buono, il Brutto, il Cattivo. Quel délice, quelle histoire, quels personnages ces trois as de la gâchette qui, durant la guerre de sécession, sont à la recherche d'un chargement d'or disparu !
Mais notre trio du moment est celui de notre curiosité aujourd’hui. Il est peut-être moins glamour, mais ô combien fascinent. Il s’agit des particules, des étoiles et des liens, en somme, les trois infinis. Tout d’abord, l'infiniment petit qui couvre l’ensemble des bizarreries du monde quantique, là où on est bien sûr innocents. Ensuite, l'infiniment grand, cet univers de nombres astronomiques, là où on est clairement insignifiants. Enfin, il y a l'infiniment complexe qui concerne le labyrinthe de nos réseaux cérébraux. Mais là, chut, on est juste inconscients.
Cette curiosité veut nous faire ressentir trois vertiges, un peu comme lorsque l’on s’éloigne du confort sur la terre ferme, qu’on s’approche du bord d’une falaise et qu’on regarde en bas. On y découvre alors une perspective inhabituelle qui déstabilise nos sens.
Dans ce cas-ci, c’est notre sens commun qui sera déstabilisé alors que nous allons explorer les trois infinis vertigineux qui débordent le spectre limité de nos sens : l’infiniment petit, avec la physique quantique; l’infiniment grand, avec l’astrophysique; et l’infiniment complexe, avec les neurosciences.
“The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it” Neil de Grasse Tyson
Nous pensons que notre cerveau, issus de l’un de ces systèmes spécialisé (ie système nerveux), est aussi compliqué qu’un ordinateur ? Détrompons-nous : il l’est bien plus, et d’une toute autre façon, malgré des influx nerveux un million de fois plus lents que l’électricité. Whenever we look at life, we look at network. Ce n’est pas juste le cerveau qui est complexe, c’est toute la vie avant lui qui a permis son émergence et toutes les sociétés humaines après qui se sont constituées grâce à lui.
Nous croyons peut-être aussi qu’un être humain n’a plus grand-chose à voir avec une bactérie ou une amibe ? Let’s think it over calmly and quietly. Ce faisant, on apprend que l’ovule fécondé d’un humain est aussi une cellule unique. Ses cellules-filles ont seulement la fâcheuse habitude de rester attachées ensemble, de se spécialiser et de se coordonner pour donner l’organisme multicellulaire complexe que nous sommes.
Alors préparons-nous à délaisser, l’espace de nos cinq minutes, le registre rassurant de la psychologie humaine dans lequel nous évoluons tous les jours avec nos croyances, nos désirs, nos convictions, et toutes ces choses évidentes que nous attribuons à nous-mêmes et aux autres. Allons découvrir le monde de la supraconductivité et de l’intrication quantique, de la vitesse indépassable de la lumière aux années-lumière, et de l’activité oscillatoire synchrone de réseaux de neurones distribués !
D’après Erich Jantsch, the self-organizing universe, la Microévolution rend possible la Macroévolution et vice versa. Nous en doutons ? C’est normal. Mais allons plus loin.
« Regarder le ciel dans le télescope est une indiscrétion ». Victor Hugo
Nous pensons par exemple que les étoiles sont bien trop loin pour avoir quelque chose à voir avec nous. Et pourtant, les atomes qui nous constituent viennent en grande partie de là. Nous pensons que la vie est apparue à un moment précis au cours de l’évolution et que l’on peut assez bien distinguer le vivant de ce qui ne l’est pas. Et pourtant, on aurait, à priori, répertorié 300 définitions de la vie dans la littérature scientifique avant d’arrêter de compter. On aurait aussi prouvé que l’évolution chimique qui a précédé l’évolution biologique pourrait bien utiliser les mêmes «procédés» que cette dernière, rendant une coupure nette entre les deux encore plus illusoire.
Le grand défi du 21ème siècle serait a priori de faire du risque systémique notre clarté. En somme, il s’agit pour nous d’appréhender clairement la complexité du réel: le fait que l’homme est tout à la fois un individu biologique et un acteur social ; le fait que dans la nature, l’ordre peut naître du désordre, et réciproquement ; et enfin le fait que ce qui limite la connaissance porte la marque du sujet qui le connaît et, qu’inversement, tout sujet connaissant porte l’empreinte du monde extérieur.
L'infiniment petit est certes observable par un Microscope. L'infiniment grand est aussi observable, à priori, par un Télescope. L'infiniment complexe se doit aussi d’être observable. Par quoi ? Certains parlent d’un Macroscope, un instrument symbolique fait de méthodes et de techniques empruntées à des disciplines très différentes.
Un tel dessein, on l’aura compris, ne s’accommode guère d’une méthode réductrice et simplificatrice, d’une méthode qui entend isoler les phénomènes de leur environnement, éliminer l’observateur de l’observation, exclure de la science tout ce qui n’entre pas dans le schéma linéaire : l’aléatoire, l’incertain, l’anormal, le compliqué.
Il s’agit, au contraire, d’adopter un paradigme qui permette de concevoir comme lié ce qui, jusqu’ici, était considéré comme disjoint. Il faut battre en brèche les cloisonnements et alternatives : dualisme de l’homme et de la nature, de la matière et de l’esprit, du sujet et de l’objet, de la cause et de l’effet, du sentiment et de la raison, de l’un et du multiple. Purée de nous autres !
«Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus de connaître le tout sans connaître les parties…» Pascal
Aujourd’hui, les problèmes sont de plus en plus transversaux, multidimensionnels, transnationaux, globaux, planétaires. Or les problèmes particuliers ne peuvent être posés et pensés correctement que dans leur contexte. En fait, le défi de la globalité est, en même temps, un défi de la complexité ; en effet, il y a bien complexité lorsque sont inséparables les composants différents constituant un tout (comme l’économique, le politique, le culturel, etc.). Une pensée incapable d’envisager le contexte et le complexe planétaire rend aveugle et irresponsable. Nous devons non seulement découper, cloisonner et isoler, mais aussi relier et recomposer.
« L’organisme restreint la créativité individuelle des unités qui le composent dans la mesure où ces unités existent pour cet organisme. Le système social humain amplifie la créativité individuelle de ses composants, dans la mesure où le système existe au service de ces composants. » Inconnu
Il s’agirait pour nous, aujourd’hui, de développer une vision globale de l'organisation du monde. Cette approche reposerait sur des systèmes interactifs qui se tiennent, s'enchainent, se bouclent, s'imbriquent créant "la complexité". Il s’agirait pour nous de développer une méthode pour analyser globalement le monde, ie une "approche systémique". Il s’agirait aussi de nous doter d’un outil, pour mettre en action tous les systèmes naturels et humains pour une société équilibrée, par exemple "le macroscope". En vue de bâtir un scénario de société équilibrée : "l'écosociété".
Selon Joël de Rosnay, l’inventeur du macroscope, la maîtrise de ces paramètres déboucherait sur une nouvelle citoyenneté définit sous l'appellation "d'Honnête Homme" du 21ème siècle.
De nos jours, post-Covid, la résistance des systèmes aux changements, à l'évolution se fait largement sentir. Il est à noter des stagnations et même possibles des retours en arrière. La décentralisation est devenue loi mais son application est plus administrative que citoyenne et elle a fabriqué plus de complexité que de simplification. Les déséquilibres écologiques ne se ralentissent pas même si la prise de conscience est indéniable. Les catastrophes industrielles, économiques, sociales, nous guettent à tout instant.
Heureusement, le progrès n'est pas linéaire et le futur n'est pas écrit d'avance. Aussi devons-nous façonner une mentalité de « jeu infini ». Autrement dit, nous devons avoir une juste cause. Et nous l’avons ! Une cause si juste que nous sacrifierions volontiers notre intérêt pour faire avancer cette cause. Nous devons avoir la confiance chevillée au corps. Une promesse infaillible pour une espérance inébranlable. Nous devons avoir une grande capacité d’agilité. S’adapter. Changer. Revisiter. Questionner. Soyons Fragile et Mobile plutôt que Solide et Immobile. Un seul objectif compte : faire avancer notre cause. L’art d’être agile est dans l’ère du temps !
Enfin, il nous faut avoir le courage de réussir. Cela signifie avoir le courage de dire: «C'est mauvais pour les affaires aujourd’hui, et nous allons le faire différemment». Les sceptiques peuvent nous appeler naïfs, mais nous devons faire la distinction entre norme et pratique, entre intérêt personnel et intérêt supérieur. Oui c’est dur mais le plaisir de servir la grande cause en vaut largement la peine.
« Nous sommes tous des poussières d’étoiles » Huber Reeves

